L’intérêt de travailler en réseau pour un travailleur social est une évidence. D’ailleurs que fait tout nouvel arrivant sur un poste de travail ? Il se constitue rapidement un réseau susceptible de lui apporter des réponses ou des éléments d’éclairage sur telle ou telle situation rencontrée. Ce n’est pas du partenariat pour autant même s’il y a un travail en commun.
Le travail en réseau est une pratique courante du travail social, le partenariat (le vrai) est plus rare.
Le mot «partenariat » est un mot « valise » très utilisé : beaucoup de professionnel(le)s parlent de partenariat sans pour autant le définir. C’est un signe : tout ou presque est appelé partenariat dès que plusieurs professionnels travaillent ensemble. Or le partenariat est une « méthode d’action coopérative fondée sur un engagement libre, mutuel et contractuel d’acteurs différents mais égaux, qui constituent un acteur collectif dans la perspective d’un changement des modalités de l’action […] et élaborent à cette fin un cadre d’action adapté au projet qui les rassemble, pour agir ensemble à partir de ce cadre. »(1)
Cette définition est un peu « prise de tête » mais elle a le mérite de la précision. Tentons de faire plus simple : le partenariat est la relation qui se veut égalitaire dans son fonctionnement entre plusieurs acteurs. Il s’agit de parvenir à un résultat commun: être partenaires oblige à se mettre d’accord sur ce que l’on va faire et comment chacun va s’engager. Des partenaires poursuivent un même objectif , leur production est commune. Chacun de ses membres peut d’ailleurs pour cela faire appel à son propre réseau qui est différent. le Partenariat est très souvent institutionnel, le travail en réseau est plus informel.
Mais alors quelles différences y a-t-il entre travail en réseau et travail en partenariat ?
Rappelons qu’un réseau, qu’il soit ou non formalisé, est un outil utilisable par chacun. Chaque membre ne poursuit pas forcément le même objectif et chaque membre ne dispose pas du même réseau que l’autre, mais il peut avoir le même public d’où la logique d’entraide et de collaboration qui est mise en œuvre. La différence peut paraître subtile . Dans les deux cas il est considéré qu’en travaillant à plusieurs en se coordonnant, il est possible de trouver des réponses ou de résoudre des difficultés que l’on ne parvient pas à prendre suffisamment en compte quand on est seul, notamment avec une personne accompagnée face à certaines difficultés.
Ainsi par exemple, l’aide et le soutien des personnes déboutées du droit d’asile, les étrangers isolés en l’absence de moyens institutionnels obligent des travailleurs sociaux à développer leurs propres réseaux avec les associations mais aussi parfois avec des particuliers bénévoles ou militants pour tenter de trouver des réponses à leurs besoins fondamentaux. Ce ne sera pas pour autant un partenariat formel où chacun définit son rôle et sa place pour une objectif commun.
J’ai l’impression que, moins les réponses sont institutionnelles plus les professionnels ont besoin de travailler en réseau car ils ne peuvent rester seuls face à des situations souvent inextricables, notamment celles qui dérangent et pour lesquelles nos institutions n’ont pas ou trop peu de réponses. Personnellement j’ai toujours apprécié travailler en réseau car cela est aussi la caractéristique d’une autonomie et marge de manœuvre du travailleur social qui trouve ainsi des réponses par lui-même grâce aux échanges qu’il engage. Cette façon d’agir permet aussi de faire de belles rencontres et de bénéficier de l’expérience de ses pairs, ce qui est toujours très utile et formateur…
(1)Fabrice DHUME, Du travail social au travail ensemble, Editions ASH, 2001
Photo : pexels


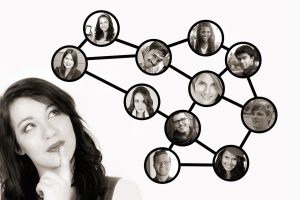


10 réponses
Bonjour,
Aujourd’hui je travaille dans une dynamique de bilan de compétences pour tenter de redonner du sens à mon quotidien professionnel. Je m’interrogeais sur les points communs et différences du travail social en réseau et en partenariat. En tant qu’éducateur spécialisé j’ai fait appel à ces deux dynamiques pendant mes 23 années de métier. Pourtant, je ne distinguais pas vraiment les caractéristiques et les valeurs de chaque notion.
Votre texte que j’ai découvert a contribué à ce que je comprenne mieux et je vous en remercie. Les commentaires des différents professionnels m’ont aussi été bénéfiques. Du coup, j’ai choisi de m’abonner. A bientôt.
Pascal
Merci de votre commentaire !DD
Bonjour,
Actuellement en 2ème année de formation préparatoire au diplôme d’ASS je dois réaliser un dossier sur le partenariat !
Pour ma part, je pense que le partenariat n’a pas besoin d’être systématiquement conventionné dès lors où les acteurs de ce partenariat veulent arriver à un but commun en ayant posé les bases de ce partenariat.
Exemple dans mon dossier CCAS et l’association où j’évolue en stage une commission s’est mise en place pour les élections de domicile mais il n’existe pas de convention ! J’aimerai légitimé ma pensé avec un apport théorique mais je n’en trouve pas…
Bien à vous
Bonjour, je suis en formation d’éducateur spécialisé 3 eme année et je rédige un dossier sur le réseau et le partenariat, dans lequel je vous cite.
J’aimerai savoir si vous aviez une idée de théorie sur la contractualisation du partenariat, ou si vous avez rédigé des articles à ce sujet?
Cordialement,
GUIBERT Manon
Bonjour,
Le partenariat n’est pas un concept qui se limite à la pratique de travail social. J’ai été formé à ce mode de collaboration lorsque je travaillais dans une entreprise privée de communication. Il m’avait à l’époque été expliqué l’importance de l’égalité de chaque partenaire notamment en matière de communication ; aucun ne doit avoir une place prépondérante notamment au titre de l’image de chaque structure qui est renvoyée. Cette égalité était considérée comme non négociable. Vous avez un article ici sur les conventions de partenariat susceptible de vous intéresser
https://www.captaincontrat.com/articles-droit-commercial/etablir-ou-rediger-une-convention-de-partenariat
Pour autant en travail social cette convention précise bien des finalités, des valeurs, des obljectifs, et les moyens pour les atteindre en précisant aussi comment les effets de ce partenariat sera évalué sans oubliar aussi les échéances. Voila pour l’essentiel. Je n’ai pas écrit d’article à ce sujet
Cordialement
Didier Dubasque
Vous devriez lire notre bouquin L’interdisciplinarité au service du travail social, Gilles ALLIÈRES et Stephane SAINT-ANDRÉ . Nous y traitons du partenariat et du réseau, de la distinction entre les deux et proposons une modélisation de formalisation du partenariat.
Votre centre de ressources a sans doute l’ouvrage dans ses rayons.
Gilles ALLIERES.
Bonjour,
Oui, c’est exact mais ces phases de tuilage ne peuvent pas toujours être mises en oeuvre (services en tension, départs brusques, dispense de préavis, etc).
De plus, la gestion par les salariés de ce capital immatériel de connaissance qu’est leur mémoire de travail et de réseau est rendu aujourd’hui plus complexe en raison des législations sur le partage d’informations, la mise en oeuvre du RGPD.
Et ce ne sont pas les dématérialisations à marche forcée qui vont arranger cela, car par exemple, certains professionnels des Administrations qui étaient capables de régler un dossier au pied levé au téléphone ne sont tout simplement plus joignables.
On s’oriente peu à peu, et pas seulement dans le champ des ESMS, vers ce que des études anglosaxonnes ont qualifié d’amnésie organisationnelle.
Cdt.
Bonjour,
Le problème majeur du travail en réseau réside dans le fait que lorsque les salariés quittent le service ou l’établissement, les nouveaux doivent à chaque fois repartir de zéro, car les ESMS sont incapables de gérer ces réseaux informels, donc hors partenariats, qu’ils n’ont pas crée institutionnellement, en tant que ressources et mémoire collective susceptibles d’être transférés aux nouveaux salariés.
Bravo pour votre travail.
Bonjour,
Merci pour votre commentaire. Vous avez tout à fait raison. D’ailleurs c’est pour cela qu’il est souvent demandé lors du départ d’un travailleur social qu’un « tuilage » soit mis en place. Celui ou celle qui part peut ainsi transmettre ses contacts à celui ou celle qui arrive, Il peut lui présenter son réseau, mais aussi les partenaires tout comme il le fait pour les personnes accompagnées. Cette pratique du tuilage tend à disparaître et c’est fort regrettable. Il est toujours difficile de repartir à zéro surtout après le départ d’un(e) professionnel(le) expérimenté(e).