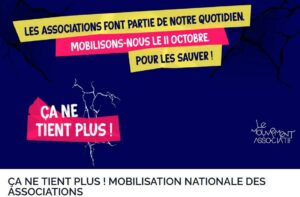Est-on sûr de pouvoir encore donner la vie, sans la perdre ? Telle est la question centrale d’un livre qui sonne l’alarme.
 Alors que le taux de mortalité était tombé de 6 ‰ en 1994 à 3,5 ‰ en 2011, le voilà remonté à 4,1 ‰ en 2024. Pour concrétiser ce pourcentage abstrait, il suffit de se représenter que le nombre de bébés qui n’ont pas survécu correspond à l’équivalent de 116 classes de maternelle ! Les autorités avancent leur explication, en évoquant des causes sociales : la mortalité infantile concernerait les femmes les plus précaires.
Alors que le taux de mortalité était tombé de 6 ‰ en 1994 à 3,5 ‰ en 2011, le voilà remonté à 4,1 ‰ en 2024. Pour concrétiser ce pourcentage abstrait, il suffit de se représenter que le nombre de bébés qui n’ont pas survécu correspond à l’équivalent de 116 classes de maternelle ! Les autorités avancent leur explication, en évoquant des causes sociales : la mortalité infantile concernerait les femmes les plus précaires.
Certes, cette précarité augmente par cinq le nombre de décès d’enfants. Mais, il est un autre chiffre qui permet d’apporter une autre interprétation possible : 75% des maternités ont fermé ces cinquante dernières années. Ce qui signifie, concrètement, que la part des parturientes vivant à 45 minutes d’une maternité a augmenté de 45%. Et quarante départements (sur cent un) n’en ont plus aucune sur leur territoire. Certains intègrent même des sage-femmes dans leurs équipes de pompiers.
Or, si 70 % de la mortalité infantile concernent les bébés prématurés, c’est aussi dans 70 % des cas dans les premiers jours que les bébés succombent. Mais, le contexte de cette mortalité infantile, n’est toutefois pas exploré avec le sérieux nécessaire, notre pays ne disposant pas d’aucun registre des naissances, comme dans beaucoup de pays européens. Cet outil permet de suivre les grossesses, les accouchements et l’état de santé tant des enfants que des parents. Notre pays possède rien moins que sept bases de données éclatées, impossibles à agréger entre elles.
Seconde piste explorée par les auteurs, la polémique régnant au sein du milieu médical quant à l’utilisation des césariennes, au profit des extractions instrumentales traditionnelles (forceps, spatules ou ventouse). Au-delà des arguments techniques, le coût de l’opération chirurgicale par rapport à la « voie basse » pouvant passer du simple au quasiment double, n’a pas laissé les autorités indifférentes. Des raisons purement budgétaires auraient-elles induit le choix d’augmenter les accouchements à risque ?
Troisième hypothèse : la précarité des petites maternités, dont 91% sont en sursis. Elles menacent de s’effondrer si l’un des quatre piliers essentiels sur lesquels elles s’appuient vient à manquer (sage-femme, pédiatre, gynécologue-obstétricien/anesthésiste). Les conditions de travail pèsent sur l’attractivité de ces professions. L’option des grosses maternités-usines à bébés n’est pas plus probante, quand leurs sage-femmes sont parfois contraintes d’assister à deux, trois, voire quatre parturientes en même temps. Alors que dans les pays nordiques, le principe qui prévaut est « one-for-one ».
Signe de la dégradation de la situation, le nombre de cliniques privées a fondu comme neige au soleil : 716 en 1975, 234 en 2003 et 107 aujourd’hui. Normal, il est bien plus rentable de poser une prothèse de hanche à 6 000 € que de procéder à un accouchement, moitié moins cher. Résultat, c’est le service public qui récupère les parturientes, parfois à flux tendu, comme à l’hôpital de Port Royal à Paris qui culmine à 5000 accouchements par an.
Chaque année, des milliers de parents vivent des drames d’horreur absolue, les auteurs en rapportant quelques récits. Alors que l’État ne retient que des responsabilités individuelles, 66 % de ces drames seraient liés à des soins jugés non optimaux. L’objectif n’est plus tant de donner la vie que d’éviter la mort. Quel chiffre de mortalité infantile faut-il atteindre pour agir, s’interroge la fin de ce livre ?
- « 4,1. Le scandale des accouchements en France » Anthony Cortes, Sébastien Leurquin, Éd. Buchet Chastel, 2025, 207 p.
Photo : Mère et nouveau-né – portrait — Image libre de droits Depositphotos