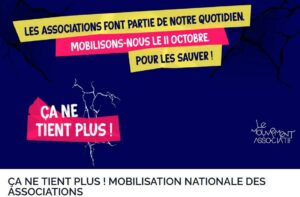C’est un chiffre qui peut tous nous interroger : en Belgique, seul un professionnel de la santé et du social sur deux se projette dans l’exercice de son métier jusqu’à la retraite. C’est peut-être pire en France. Une enquête nationale Be.well.pro, pilotée entre janvier et mars 2025 nous donne à voir un instantané d’une profession en tension. Sous la surface d’un attachement sincère au travail et d’un solide sentiment d’appartenance se cache une fatigue profonde, une crise de reconnaissance et, surtout, une difficulté grandissante à tenir dans la durée. Cela ne vous rappelle rien ?
Cette photographie collective ne se limite pas aux seuls chiffres ; elle raconte aussi la fierté, la solidarité entre pairs, le goût pour l’accompagnement et j’en passe. Ce sont autant de qualités qui, paradoxalement, coexistent avec un taux alarmant d’épuisement et de découragement. En Belgique, près de 35.000 personnes, issues de 41 métiers différents, ont témoigné : des hôpitaux aux services sociaux des régions, de la première ligne aux structures d’aide sociale, c’est tout un paysage professionnel qui s’est exprimé. Cette parole met à nu l’ambivalence du quotidien : l’appétence pour le collectif y côtoie la difficulté de surmonter la charge de travail, le stress, mais aussi le manque d’estime institutionnel.
Burn-out, insatisfaction et précarité psychologique : l’ordinaire du terrain
Que révèle cette enquête réalisée chez nos voisins belges ? Le constat est sans appel : 12,5 % des répondants affichent un risque (très) élevé de burn-out, avec une incidence forte chez les 25–44 ans. Plus inquiétant encore, près de 41,4 % déclarent se sentir « mentalement ou physiquement épuisés par leur travail ». En toile de fond, il y a l’expression d’une insatisfaction (8,4 %) et une forme de « dénuement symbolique » : un quart des personnes interrogées affirme ne pas se sentir suffisamment valorisé dans ses fonctions.
C’est tout l’équilibre de vie qui vacille : 68,6 % des professionnels perçoivent un impact négatif de leur emploi sur leur vie privée. Face à cette réalité, la projection dans la durée devient hypothétique : seule la moitié des professionnel(le)s interrogé(e)s visualise encore la possibilité de « tenir » jusqu’à la retraite, et une part décisive déclare qu’une adaptation du travail serait le levier pour continuer.
Les travailleurs sociaux belges : entre savoir-faire invisible et conditions de travail dégradées
Le rapport SPF Santé publique/Sciensano replace explicitement l’apport des travailleurs sociaux au cœur de ce diagnostic. Leur mission : retisser les solidarités, valoriser les ressources des personnes accompagnées, agir en interface avec l’ensemble des partenaires du territoire et construire des réponses collectives autant qu’individuelles, etc. Ce rôle d’“agent de lien” — fondé sur la confiance, la discrétion, l’écoute et l’éthique — requiert une disponibilité et un art du discernement constant, dans un environnement marqué par la complexité institutionnelle et le manque de moyens.
L’expertise des assistants sociaux et travailleurs de première ligne est unanimement reconnue dans ses fondements : capacité à évaluer globalement les situations, à co-construire des plans d’action individualisés ou collectifs, à mobiliser et articuler des réseaux d’acteurs, à instaurer une dynamique participative. Pourtant, cette expertise reste trop souvent invisible, parce que les résultats positifs d’un accompagnement, ou les souffrances contenues, ne font jamais la une des bilans d’activité.
À cette compétence de régulation du lien social s’ajoute une nécessité de plus en plus pressante : défendre une démarche éthique. Dans un contexte où la pression managériale et la logique de résultats menacent l’esprit de la profession, il est difficile de concilier le sens et les valeurs que l’on porte aux autres mais aussi à sa pratique. Le respect de la singularité, la confidentialité, la coconstruction des solutions : autant de repères qui sont aujourd’hui entravés par des conditions de travail qui altèrent la disponibilité mentale et l’investissement à long terme.
L’urgence d’un sursaut structurel pour une gestion humaine et une politiques de bien-être
Les recommandations issues du baromètre Be.well.pro demandent un engagement politique fort. D’abord, il faut pouvoir repenser le management : promouvoir un accompagnement centré sur le bien-être mental, renforcer les compétences relationnelles et éthiques des cadres, développer une culture de la reconnaissance et de la participation. Les chercheurs insistent sur la nécessité d’investir dès la formation dans un encadrement-soutien authentique, capable de porter une vision humaine de l’organisation.
Le deuxième axe d’évolution concerne l’équilibre vie professionnelle/vie privée. Les politiques d’ajustement des organisations du travail — rythmes, horaires, modèles de rotation et gestion partagée de la charge — sont jugées incontournables. Tout laisse à penser qu’il s’agit moins d’adapter les personnes que de transformer durablement les environnements de travail pour prévenir l’épuisement. Cette transformation implique aussi la formation, notamment pour les jeunes générations et pour les métiers à forte intensité clinique.
À ces sujets s’ajoute le besoin, trop souvent ignoré, d’individualiser les politiques de bien-être. Les attentes et les contraintes ne sont pas les mêmes pour les jeunes professionnels et pour les salariés en fin de carrière, entre les secteurs du soin et le champ social. Il s’agit d’en finir avec les approches uniformes et de proposer des dispositifs de mentorat et de développement des carrières sur-mesure, capables de répondre à la diversité réelle des trajectoires.
Les métiers de l’utilité sociale en mal de validation
À travers ces diagnostics, se dessine un paradoxe de taille : La société attend des travailleurs du soin et du service social qu’ils incarnent au quotidien les valeurs de solidarité, d’ouverture alors que leur reconnaissance symbolique et matérielle accuse un retard flagrant. La question de la valorisation n’est pas qu’une affaire financière ; elle touche à la qualité du dialogue professionnel, à la place accordée à la parole de terrain dans les choix d’orientation des politiques publiques. Le livre blanc du travail social en France ne dit pas autre chose.
Les professionnels interrogés affirment leur volonté de rester engagés… mais seulement à condition de voir leur parole prise en compte. A condition aussi que leurs missions respectées et leur autonomie préservée. Ce besoin de négociation, d’écoute et d’ajustement des cadres institutionnels constitue un élément central qui permet une fidélisation des équipes, aujourd’hui plus que jamais fragilisées.
Conclusion ouverte : pour un pacte éthique et social renouvelé
Il est temps de dépasser la simple rhétorique de la crise permanente pour ouvrir un débat sur la finalité du travail social et du soin dans nos sociétés. Réparer, soulager, redonner confiance, animer la vie collective : autant de missions essentielles dont la portée n’est ni quantifiable ni délocalisable. Et ce n’est pas l’intelligence artificielle qui parviendra à prendre le relai sur ces missions.
Au fil de cette enquête, une certitude apparait : si les travailleurs sociaux, et tous les professionnels du lien, venaient à se détourner de leurs métiers, le tissu social s’effilocherait irrémédiablement. Leur expertise, leur intelligence du contexte, leur capacité à travailler dans “l’entre-deux” des bureaucraties et des personnes accompagnées, dessinent, souvent en filigrane, une résistance obstinée à la déshumanisation du soin et de l’aide.
Restaurer l’espoir passe donc par une reconnaissance tangible, une écoute renouvelée et des politiques de soutien lisibles. C’est sur ce terrain qu’il faudra, dans les années à venir, juger du pacte collectif : saura-t-on enfin voir, entendre et valoriser celles et ceux dont le métier, souvent invisible, construit la société dans ses moments les plus vulnérables ?
Sources :
- “Tenir jusqu’à la retraite : mission impossible pour la moitié du personnel du soin et du social” | Pro Guide Social.
- Be.well.pro rapport groupe professionnel Travailleur social / Assistant social Étude réalisée par Sciensano à la demande du SPF Santé publique (Belgique)
photo :