L’empathie, cette capacité fondamentale à comprendre et partager les états émotionnels d’autrui, constitue l’un des piliers de nos relations sociales et de notre humanité. Ce concept est bien connu des travailleurs sociaux qui en font preuve au quotidien. Pourtant, cette qualité humaine peut se transformer en vulnérabilité face aux nouvelles formes de manipulation émotionnelle via les réseaux sociaux. Les expériences menées par Facebook il y a plus de dix ans nous en apprennent beaucoup sur ce sujet et il me parait important de les partager avec vous.
Pour résumer, l’empathie comporte trois caractéristiques principales nous dit Emmanuelle Glon auteure d’un article publié par les Presses Universitaires de Nanterre. Elle repose d’abord sur un partage affectif non-conscient et automatique avec autrui. Sa seconde caractéristique se situe dans « la capacité à imaginer le monde subjectif de l’autre en utilisant ses propres ressources mentales ». Enfin, l’empathie implique la nécessité de supprimer temporairement et consciemment sa propre perspective subjective pour se mettre à la place de l’autre sans perte d’identité.
Les mécanismes de l’empathie : entre connexion et vulnérabilité
Les recherches en neurosciences distinguent aujourd’hui plusieurs formes d’empathie qui interagissent de manière complexe. L’empathie cognitive correspond à la capacité de comprendre rationnellement les pensées, sentiments et motivations d’une autre personne, tandis que l’empathie affective consiste à ressentir émotionnellement ce que l’autre éprouve. Cette distinction s’avère déterminante pour comprendre comment certains individus peuvent exploiter ces mécanismes à des fins manipulatrices. Car c’est malheureusement bien de cela qu’il s’agit.
Les neurosciences révèlent que l’empathie repose sur des réseaux neuronaux sophistiqués. Nous sommes face à un système des neurones miroirs, qui nous permettent de simuler dans notre propre cerveau les actions et émotions observées chez autrui. Cette simulation neuronale automatique constitue le fondement de notre capacité à comprendre les autres, mais elle nous rend également vulnérables à la contagion émotionnelle, processus par lequel nous adoptons inconsciemment les états affectifs d’autrui.
La contagion émotionnelle : un mécanisme primitif exploitable
La contagion émotionnelle se distingue nettement de l’empathie par l’absence de distance critique. Là où l’empathie maintient une séparation entre soi et l’autre, la contagion émotionnelle nous fait éprouver les émotions d’autrui comme si elles étaient nôtres. Ce phénomène spontané, involontaire et non conscient trouve ses racines dans notre évolution : il favoriserait la survie du groupe en permettant la transmission rapide de signaux d’alarme.
Les chercheurs ont démontré que les émotions peuvent se transmettre d’un individu à un autre quasi instantanément. Ce processus repose sur notre tendance innée à imiter les mimiques faciales, les vocalisations et les postures de nos interlocuteurs, activation qui déclenche en retour les mêmes émotions dans notre cerveau limbique. Là où cela se complique c’est quand des chercheurs payés par des géants de la tech, comprennent et expliquent ce phénomène une fois appliqué aux réseaux sociaux.
Les expériences de Facebook : manipulation à l’échelle industrielle
Entre le 11 et le 18 janvier 2012, Facebook avait mené secrètement une expérience d’une ampleur inédite sur 689.003 utilisateurs anglophones. Cela avait été rendu public dès 2014. Sans leur consentement, le réseau social avait manipulé leurs fils d’actualité pour exposer certains utilisateurs à des contenus majoritairement positifs et d’autres à des messages principalement négatifs. L’objectif : tester la « contagion émotionnelle » à grande échelle.
Les résultats furent sans appel : les utilisateurs exposés à des messages positifs produisaient davantage de contenus positifs, tandis que ceux confrontés à des messages négatifs adoptaient un vocabulaire plus sombre. Cette expérience démontrait que « les états émotionnels sont communicatifs et peuvent se transmettre par un phénomène de contagion, conduisant les autres personnes à ressentir les mêmes émotions sans en être conscientes ».
Voilà qui rend cette expérience particulièrement préoccupante. Elle a révélé la possibilité de manipuler les émotions et comportements de millions d’individus sans interaction directe, uniquement par la sélection algorithmique des contenus. L’équipe de recherche de Facebook avait d’ailleurs mené plus de 1000 expériences similaires depuis sa création en 2007, sans garde-fou ni conseil scientifique interne. Onze années ont passé et nous voyons le résultat aujourd’hui.
L’empathie comme facteur de vulnérabilité
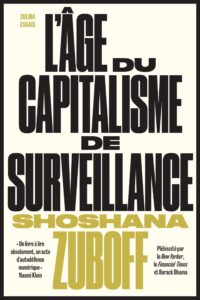 Comme le souligne Shoshana Zuboff, dans son ouvrage « l’âge du capitalisme de surveillance », Facebook a délibérément omis un élément fondamental dans ses études : « la sensibilité d’un individu à des amorces subliminales et sa vulnérabilité à l’effet de contagion dépendent largement de l’empathie ». Plus une personne possède une capacité empathique développée, plus elle sera susceptible d’être influencée par des stimuli émotionnels subtils.
Comme le souligne Shoshana Zuboff, dans son ouvrage « l’âge du capitalisme de surveillance », Facebook a délibérément omis un élément fondamental dans ses études : « la sensibilité d’un individu à des amorces subliminales et sa vulnérabilité à l’effet de contagion dépendent largement de l’empathie ». Plus une personne possède une capacité empathique développée, plus elle sera susceptible d’être influencée par des stimuli émotionnels subtils.
Paradoxalement, cette qualité humaine essentielle aux rapports sociaux et affectifs peut devenir « une force fragile ». Elle nous prédispose à faire « l’expérience du bonheur des autres mais aussi de leurs douleurs ». Cette sensibilité accrue aux émotions d’autrui constitue une porte d’entrée pour les techniques de manipulation émotionnelle.
L’instrumentalisation de nos émotions
Shoshana Zuboff, dans son analyse du capitalisme de surveillance, dénonce cette mutation du capitalisme où les géants technologiques ne se contentent plus de collecter nos données. Elles cherchent désormais à « orienter, modifier et conditionner tous nos comportements : notre vie sociale, nos émotions, nos pensées les plus intimes ». Cette nouvelle forme d’exploitation économique repose sur l’instrumentalisation de notre empathie et de notre vulnérabilité à la contagion émotionnelle.
Les plateformes numériques exploitent systématiquement ces mécanismes psychologiques. Leurs algorithmes privilégient les contenus émotionnellement chargés car ils génèrent plus d’engagement. Une étude sur X ex-Twitter révèle qu’un message exprimant une émotion a 20% de chances supplémentaires d’être partagé, particulièrement lorsqu’il s’agit d’émotions négatives.
De sérieuses menaces pour la démocratie
Cette manipulation émotionnelle industrielle pose des risques majeurs pour nos systèmes démocratiques. La polarisation affective, phénomène d’animosité croissante entre partisans de différents bords politiques, se trouve amplifiée par ces mécanismes de contagion émotionnelle. Tout cela est documenté.
Les algorithmes des réseaux sociaux, en privilégiant les contenus suscitant des réactions émotionnelles intenses, favorisent structurellement la diffusion d’informations clivantes et extremes. Le président de la République Emmanuel Macron en a fait l’expérience. Il observait récemment que « avec les réseaux sociaux, l’émotion est plus forte que l’argument et l’émotion négative est plus forte que l’émotion positive », créant un environnement informationnel qui « favorise les extrêmes ». Sa politique aussi peut être, mais là n’est pas le sujet?
Eva Illouz, sociologue spécialisée dans l’étude des émotions en politique, a analysé comment le discours populiste mobilise quatre registres émotionnels principaux : la peur, le dégoût, le ressentiment et l’amour de la patrie. Ces émotions, amplifiées par les mécanismes de contagion sur les réseaux sociaux, peuvent « offrir des causes aux pertes subies en identifiant un ennemi » et conduire vers « une tendance préludant au fascisme ».
Les mécanismes de polarisation émotionnelle
Les recherches en psychologie sociale révèlent que notre empathie naturelle peut être détournée par des stratégies de manipulation sophistiquées. Les GAFAM utilisent leurs capacités de compréhension émotionnelle non pour aider autrui, mais pour exercer leur propre domination au service de leurs idées. Cette empathie toxique « pervertit nos qualités humaines pour manipuler et nuire à nos émotions »
Sur les réseaux sociaux, cette dynamique se trouve décuplée par l’effet de « bulle de filtres ». Les algorithmes, en privilégiant des contenus similaires à ceux que nous avons déjà appréciés, nous enferment progressivement dans des espaces informationnels homogènes. Dans ces bulles cognitives, c’est celui qui est le plus radical qui tire les autres.
Les conséquences sur le débat démocratique
Cette polarisation émotionnelle transforme l’espace public démocratique. Plutôt qu’un lieu de confrontation d’idées rationnelles, il devient « un théâtre de réactions affectives en boucle ». L’indignation, la colère et la révolte « circulent à travers les réseaux sociaux comme un virus contagieux », créant un « effet de duplication émotionnelle ».
Cette dynamique encourage une polarisation accrue des débats politiques. Elle pousse les individus à « ajuster l’expression de leurs émotions en fonction des personnes qui les suivent ». L’expression émotionnelle devient « performative, stratégique, et parfois même mimétique », minant l’authenticité du débat public.lejournal.cnrs
Les conséquences de cette polarisation numérique sont multiples : fragmentation de l’espace public, radicalisation des opinions, propagation accélérée de la désinformation, et perte de confiance envers les institutions. Cette érosion du tissu social démocratique constitue l’un des principaux enjeux politiques de notre époque.
La nécessité d’une régulation éthique
Face à ces enjeux, la question de la régulation éthique des expérimentations comportementales devient un enjeu majeur. L’expérience de Facebook de 2012 avait été menée en violation des standards éthiques les plus élémentaires : aucun consentement informé, absence de comité d’éthique, et modification rétroactive des conditions d’utilisation pour légaliser a posteriori l’expérimentation. Bref ceci explique pour partie pourquoi, j’ai quitté Facebook quand j’ai découvert cette expérimentation.
Il est assez inssuportable d’être considérés par les GAFAM comme des »calculés » manipulables à l’envi tout simplement parce que nous faisons preuve d’empathie avec les autre. Cette mécanisque pernicieuse nous envoie tout droit dans un monde d’intolérance qui donne le pouvoir aux extrémistes qui pullulent sur les réseaux sociaux bien au delà leur nombre réel. Ils voient leurs messages démultipliés par des algorithmes, alors que les plus raisonnables sont minorés car ils suscitent moins d’engagement.
Mais il ne faut pas s’affoler. Il est possible de faire preuve d’empathie sans pour autant gober les fausses informations ou être attiré par les idées extrèmes ou polarisantes. Comment ? En ayant la conscience de soi. En étant capable de réfléchir et d’analyser notre propre comportement pour déceler comment les messages arrivent sur nos fils de discussion et pourquoi. Cela demande de la vigilance bien évidemment.
Mais que faire aujourd’hui ?
Pour préserver notre démocratie face à ces nouvelles formes de manipulation, il devient essentiel de développer ce que nous pourrions appeler une « empathie critique ». Cette approche consisterait à maintenir notre capacité de connexion émotionnelle avec autrui tout en développant une distance réflexive vis-à-vis de nos propres réactions émotionnelles.
Les neurosciences nous apprennent que notre cerveau conserve une plasticité qui nous permet d’acquérir de nouvelles compétences cognitives. Il est donc possible de développer des stratégies de protection contre la manipulation émotionnelle tout en préservant notre humanité empathique.
Cette éducation à l’empathie critique devrait inclure une meilleure compréhension des mécanismes de contagion émotionnelle. Une formation à l’analyse critique des sources d’information est désormais nécessaire. Il nous faut savoir développer une conscience de l’existence des biais cognitifs. Ce sont eux qui nous rendent vulnérables aux manipulations. Quant aux manipulateurs, il faut s’en séparer même si c’est difficile.
Conclusion : préserver l’empathie dans un monde numérique
Quoi qu’on pense de tout cela, l’empathie demeure une qualité humaine fondamentale. Elle reste essentielle à nos relations sociales et à notre fonctionnement démocratique. Cependant, les révélations sur les expériences de Facebook et l’émergence du capitalisme de surveillance qui visent à manipuler nos choix inconscients nous obligent à repenser notre façon d’agir de le monde numérique.
Face à ces enjeux, il ne s’agit pas de renoncer à l’empathie, mais de la cultiver de manière éclairée et critique. En comprenant mieux les mécanismes neurologiques et psychologiques qui nous rendent vulnérables à la manipulation, nous pouvons développer des stratégies de protection tout en préservant notre capacité à nous connecter authentiquement aux autres.
L’avenir de nos démocraties dépendra en partie de notre capacité à naviguer dans cet environnement numérique complexe sans perdre notre humanité. Cela nécessite une prise de conscience collective des enjeux, une régulation éthique rigoureuse des plateformes technologiques, et une éducation citoyenne adaptée aux réalités de notre époque. Car comme le souligne Shoshana Zuboff, cette lutte pour préserver notre autonomie émotionnelle et cognitive constitue ni plus ni moins qu’un « combat pour l’avenir humain ».
Sources :
- Émotion empathique et cognition sociale | OpenEdition Books
- L’empathie : le cerveau social, pilote de nos émotions et de notre santé | Les Fourmis Empathiques
- L’empathie : ce qu’en disent les neurosciences | Intermédies Médiation
- Une vaste opération de manipulation des émotions via Facebook | Sciences et Avenir
- Des utilisateurs de Facebook manipulés pour une expérience psychologique | Le Monde
- L’âge du capitalisme de surveillance | Zulma
- Les émotions façonnent nos démocraties capitalistes | Le Journal du CNRS
- L’émotion est plus forte que l’argument : Macron pointe le rôle des réseaux sociaux dans la montée des extrêmes | BFMTV
- Les médias sociaux polarisent-ils ? | FMSH
- La polarisation sur les réseaux sociaux : impact des biais cognitifs | Observatoire Numérique




Une réponse
Lire » lesprit.critique » pour aider a décortiquer les manipulations