Dans une France toujours autant marquée par l’urgence sociale, la précarité alimentaire reste un révélateur singulier des inégalités. C’est pourquoi le dernier numéro (298) de la Revue française de service social est particulièrement bienvenu. Il consacre ses pages à ce phénomène trop peu mis en avant. Il explore les réponses institutionnelles et de terrain et interroge le rôle des professionnels de l’accompagnement. Alors que les dispositifs d’aide peinent à endiguer la progression de cette précarité, la revue nous propose une voie alternative portée par du sens : considérer l’accès à une alimentation de qualité – et, tout particulièrement, aux aliments non transformés issus de circuits courts – comme un droit universel plutôt qu’une assistance soumise à conditions.
Alimentation et identité sociale : la fracture invisible
L’analyse sociologique nous rappelle combien les pratiques alimentaires reflètent et renforcent les positions sociales. Le sociologue Pierre Bourdieu parlait, dès 1979, des « goûts de luxe » et des « goûts de nécessité ». Ce sont eux qui séparent les classes supérieures des catégories populaires. Aujourd’hui, ces distinctions s’accentuent. Pire, elles se transforment en « nécessités de survie » pour les plus précaires. Faut-il rappeler que 16 % des Français déclarent ne pas manger suffisamment et que 51 % accèdent à une nourriture qui ne correspond pas à leurs attentes ? L’alimentation devient alors le miroir des ressources et des contraintes propres à chaque famille, inscrivant dans le quotidien les inégalités d’accès au bien-manger.
Loin d’être un simple enjeu de « pouvoir d’achat » ou de « gestion de la pauvreté », le choix alimentaire touche à la dignité et à l’autonomie. Derrière la dureté des chiffres, s’exprime un paradoxe puissant : dans un pays où la culture gastronomique est célébrée, beaucoup refusent de demander une aide, rebutés par la stigmatisation associée au système caritatif. Les professionnels du social, en première ligne face à cette crise silencieuse, sont témoins de cette complexité : il leur faut accompagner les personnes, tout en devant les orienter vers des dispositifs dépendant des surplus agro-industriels qui ne sont pas vraiment bons pour la santé. C’est désormais documenté.
Les circuits courts, terrain d’innovation et de justice sociale
La question de la transformation des systèmes d’approvisionnement occupe une place centrale lorsque que l’on se penche sur la précarité alimentaire. Les circuits courts, qui privilégient la relation directe entre producteurs et consommateurs, s’affirment comme une alternative crédible au modèle agro-industriel dominant. Ils valorisent les produits non transformés – légumes bruts, fruits frais, viandes issues d’élevages locaux –, réduisant les intermédiaires et les manipulations tout le long de la chaîne alimentaire. Je repense avec nostalgie, à l’atelier cuisine que j’avais pu mettre en place avec une élue dans la commune où j’exerçais. Les Restaurants du cœur cultivaient à l’époque un immense jardin bio et produisaient directement leurs légumes pour les distributions. Nous allions qualité des produits et l’art de les accomoder avec des allocataires du RSA qui étaient ravis et presque autant gourmands que moi.
Cette proximité logistique et humaine avait de grands avantages. Elle en a encore aujourd’hui car cette approche limite les pertes, favorise la valorisation de la diversité agricole et réduit le gaspillage. Elle permet aussi d’offrir, au sein de dispositifs innovants, des prix adaptés, des paniers solidaires ou différenciés. C’est une forme de justice : permettre l’accès à des aliments de qualité, moins tributaire du statut social. Toutefois, la question de l’accessibilité demeure délicate : le prix de vente lié aux circuits courts, non soutenu par les subventions agricoles qui profitent massivement à l’agro-industrie, freine l’ouverture à tous les foyers. Des initiatives socio-solidaires, telles que les AMAP ou les jardins de Cocagne, cherchent à renverser cette dynamique.
Les professionnels du social, conscience critique et force d’entraînement
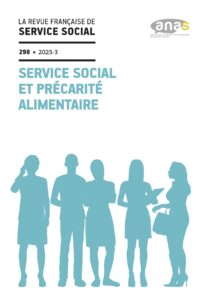 Dans ce contexte, le rôle des assistants de service social et des travailleurs de l’accompagnement se révèle décisif. Principal prescripteur de l’aide alimentaire, l’assistant social évolue dans une tension éthique : il doit accompagner vers l’autonomie, tout en prenant part à un système qui perpétue le recours aux produits excédentaires de l’industrie agroalimentaire. Cette prescription, jugée de plus en plus anachronique et critiquée comme une forme de « domestication mutuelle », appelle à un changement de paradigme.
Dans ce contexte, le rôle des assistants de service social et des travailleurs de l’accompagnement se révèle décisif. Principal prescripteur de l’aide alimentaire, l’assistant social évolue dans une tension éthique : il doit accompagner vers l’autonomie, tout en prenant part à un système qui perpétue le recours aux produits excédentaires de l’industrie agroalimentaire. Cette prescription, jugée de plus en plus anachronique et critiquée comme une forme de « domestication mutuelle », appelle à un changement de paradigme.
L’expertise des professionnels de l’accompagnement s’enrichit alors de dimensions nouvelles. Non seulement ils deviennent les médiateurs d’un accès plus juste à la qualité alimentaire, mais ils participent à la transformation des logiques institutionnelles : soutien à l’agir collectif, animation de groupes, plaidoyer pour une approche radicale du droit à l’alimentation. Des expérimentations territoriales existent actuellement. Elles sont inspirées du modèle de Sécurité sociale de l’alimentation. Elles reposent sur l’universalité, la cotisation et le conventionnement démocratique. Cette approche déplace le regard du caritatif vers une citoyenneté alimentaire. Ce numéro de la revue nous permet par exemple de découvrir l’expérimentation de la Sécurité sociale de l’alimentation en Charente.
Penser la justice alimentaire : du soutien individuel à l’émancipation collective
La démarche éthique portée par les professionnels du social invite à dépasser la gestion individualisée de la précarité. Elle requiert une actualisation des pratiques et des fondements cliniques : comment prendre en compte les différences culturelles dans un système standardisé ? Comment respecter la liberté des personnes quand le choix est réduit à l’offre industrielle à grand renfort de publicités ? L’alimentation, loin d’être un simple geste physiologique, revêt une dimension culturelle profonde et peut, dès lors, devenir le support du lien social.
Le numéro 298 de la revue propose de nombreux exemples : associations militantes, jardins partagés, supermarchés coopératifs, démarches d’éducation populaire. Ces initiatives illustrent, par le terrain, la capacité d’innovation des acteurs du social ainsi que leur engagement à recomposer les liens communautaires autour de la nourriture. Il s’agit bien plus que de redistribuer des surplus : il s’agit de rendre à chacun la maîtrise de son approvisionnement, de son alimentation, de ses rapports à la Terre et aux lieux. Mathieu Levoir nous présente aionsi l’association VRAC qui permet aux habitants de quartiers populaires d’accéder à une alimentation de qualité. Il y a une véritable analyse politique dans ce projet qu’il faudrait pouvoir démultiplier sur tout le territoire.
Reconnaître et valoriser les métiers de l’aide : paroles d’engagement
Cette transformation ne sera possible qu’à la condition d’une reconnaissance réelle des missions et du rôle des travailleurs sociaux dans ce domaine. Le numéro valorise leur expertise : diagnostic des situations, inventivité dans la création de dispositifs, accompagnement des personnes dans leur diversité, soutien à la prise de parole citoyenne. Cette posture engagée, attentive aux dimensions politiques de l’alimentation, renforce la légitimité de nos métiers. Elle interroge aussi la pertinence des politiques publiques dans ce domaine.
En effet, la lutte contre la précarité alimentaire se joue aussi dans l’arène institutionnelle. Elle impose aux travailleurs sociaux de revendiquer des transformations structurelles, d’appeler à la généralisation des modèles fondés sur les circuits courts et le conventionnement des producteurs engagés. Elle exige, face à la montée des exclusions, une vigilance et une force de proposition pour que la dignité, l’autonomie et l’émancipation redeviennent les principes structurants de l’accompagnement.
Vers une sécurité sociale de l’alimentation : horizon d’émancipation
Enfin, la revue examine un enjeu majeur. Celui de la sécurité sociale de l’alimentation, développé dans un article signé Bernard Friot. Que veut dire « mettre l’alimentation en Sécurité sociale ? » demande-t-il. Rompant avec la logique marchande et caritative, cette conception repose sur un droit universel à l’alimentation choisie et de qualité, financé par la cotisation sociale et géré démocratiquement. Elle présuppose une transformation profonde du rapport au travail, valorisant une activité « conventionnée » tournée vers l’intérêt collectif, à l’encontre du modèle agro-industriel qui fragmente et aliène les acteurs de la filière.
Cette Sécurité sociale de l’alimentation, pensée comme un levier de justice, pose la question des réformes à venir et des modèles à inventer. Le mouvement, bien qu’en phase expérimentale dans quelques territoires, trace une perspective enthousiasmante : sortir du paradigme du « pouvoir d’achat » pour construire une société où chacun prend part, selon ses moyens, à la production, à la décision et à la distribution des aliments. Ce projet, viserait à « conventionner les travailleurs engagés dans le changement ». Il redonne aux circuits courts et aux produits non transformés leur place : vecteurs de responsabilité, de solidarité et d’écologie humaine.
Conclusion ouverte : la dignité alimentaire comme horizon politique
Le numéro 298 de la Revue française de service social dessine un idéal : celui d’une société capable de garantir à toutes et tous le droit à une alimentation saine, diversifiée, locale et non transformée. Les travailleurs sociaux, acteurs résolus et témoins lucides, se voient ici à la fois porteurs d’une clé d’émancipation et d’une conscience critique. Il s’agit de valoriser des réponses qui dépassent le traitement des symptômes pour s’attaquer aux causes des inégalités.
Penser local dans une perspective d’émancipation et de solidarité c’est ce que nous montre ce numéro de la Revue Française de Service social que je vous invite à vous procurer. Cela en souhaitant que cette réflexion éclaire votre propre engagement et suscite de nouveaux échanges, sur le terrain comme dans les institutions. Car la dignité alimentaire, l’accès aux circuits courts et la valorisation du métier de l’aide sont autant de défis à relever collectivement pour construire un avenir, enfin, solidaire et humain.
Numéro coordonné par Dany Bocquet et Joran Le Gall
Sommaire :
- PREMIÈRE PARTIE : L’ALIMENTATION, MIROIR DES CHOIX POLITIQUES ET DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ
- L’alimentation et ses fonctions : approche sociologique et anthropologique par Émilie Salvat
- ASS vers SSA, renversement pour un ordre démocratique. Petit manuel d’éducation populaire pour un droit à l’alimentation par et pour tou·te·s par Loïc Bronnec
- Le cœur politique de la sécurité sociale de l’alimentation Maxime Scaduto
- Que veut dire « mettre l’alimentation en sécurité sociale » ? Bernard Friot
- DEUXIÈME PARTIE : MOBILISATIONS COLLECTIVES : AGIR POUR L’ACCÈS À L’ALIMENTATION
- Expérimentations de la sécurité sociale de l’alimentation en Charente Direction de la Communication du département de la Charente
- VRAC, une association qui fait de l’alimentation de qualité un droit dans les quartiers populaires Mathieu Levoir
- Le jardin, un outil d’autonomie et de transformation sociale Xavier Hubert
- La Louve : qu’est-ce que c’est ? Tom Boothe
- TROISIÈME PARTIE : PRATIQUES DU SERVICE SOCIAL : QUESTIONNER, INNOVER, S’ENGAGER
- L’aide alimentaire, un anachronisme persistant dans l’action sociale. Réflexions critiques sur une pratique entre héritage symbolique et enjeux contemporains Claude Bentamouch
- Quand le prix détermine le choix alimentaire, le droit à l’alimentation devient une mission impossible Bénédicte Bonzi
- L’accès à l’alimentation : un enjeu social et citoyen au cœur de l’action collective Alix Dulong
- Service social et droit à l’alimentation : vers une approche radicale Interview de Dominique Paturel par Dany Bocquet et Joran Le Gall



